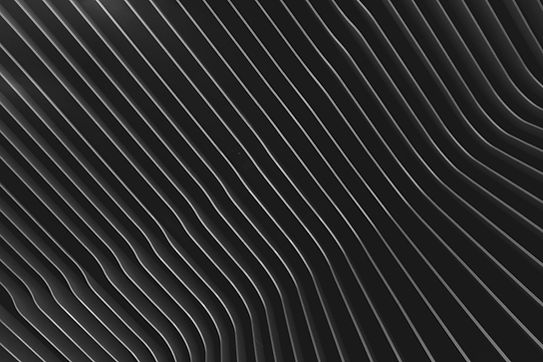
1, 2, 3, nous irons au bois...
Qu’étaient-ils venus faire dans cette galère ? Jésus, Marie et le Saint Graal ; les celtes, les romains, les wisigoths et les Mérovingiens ; les Cathares et les Templiers ; les seigneurs du Razès ; St Roch, St Antoine et Ste Germaine de Pibrac ; Rabelais et Flamel ; les Ducs de Bar et de Lorraine ; Nostradamus ; Mgr JJ Olier et les Sulpiciens, St Vincent de Paul et Nicolas Pavillon ; Nicolas Poussin, David Teniers le jeune, les Fouquet et Louis XIV ; Mgr de Bonnechose, Chateaubriand, Delacroix, Signol, Victor Hugo, Jules Verne, Maurice Leblanc, les Curés du Razès et Fulcanelli ; Michel Sardou et Art Mengo.
Partie 1/3
Petit précis historique
Le Haut Razès, rattaché au diocèse d'Alet en 1318, est la partie ouest du massif des Corbières (le nid de corbeaux), délimité au nord par le signal d'Alaric, au sud par les Fenouillèdes, à l'ouest, par la vallée de l'Aude, à l'est par la plaine du Roussillon. Cette région, aux défenses naturelles indéniables, accueillit dès la préhistoire une présence humaine. Elle fût envahie par les Volkes Tectosages. « Leur habileté équestre donnera à la population locale le nom de Redones* (d'une racine celtique "red" signifiant : aller à cheval) puis à leur capitale le nom de Rhedae* (du gaulois "reda", le char) ».
Puis les romains investirent la région, le Pagus Electensis, attirés par ses nombreuses sources chaudes. Ils y fondèrent des cités thermales d'Aqua Caldae dont celle qui deviendra les bains de Montferrand.
Les wisigoths prirent ensuite possession de la région, assimilés eux-mêmes par les francs mérovingiens.
La région va servir de coffre-fort où sera remisé le fruit des rapines de ces différents peuples.
Brennus (chef de guerre celte) pille Delphes en 279 avant JC. Une légende prétend que les celtes, hormis certains trésors sacrés, se débarrassaient de leur butin, jugé impur, en le jetant au fond des plans d'eau ou en le remisant en des enclos sacrés (rings), dans le but d'asservir les dépouillés (rituel magique de l'or maudit).
Le nom des Volskes Tectosages proviendrait de deux mots germaniques « Teich» (l’étang) et «Sage» (la légende). Ce trésor, l’or de Toulouse, est capté par l’envahisseur romain mais disparaît dans les Corbières, lors de son rapatriement vers Rome, sous la responsabilité du Proconsul Quintus Servilius Cepion.
Alaric I pille Rome en 410 et fait main basse sur le butin de Titus provenant du saccage de Jérusalem en 70.
Un point de détail qui a son importance : les wisigoths (le peuple avisé et instruit) à partir de 341 se sont convertis à l'arianisme de l'évêque Wulfina. Autant dire qu'ils étaient prêts à défendre et sauvegarder des idées "hérétiques" concernant le canon catholique.
Cathare pourrait ainsi venir de "Casti Arius".
Les persécuteurs deviendront les persécutés !
En 1291, Saint Jean d'Acres tombe aux mains de Saladin. Les Templiers ont juste le temps de rapatrier leur trésor, à Chypre d'abord, puis de commanderie en commanderie, jusqu'en France, pour finir, en 1294* (une date immortalisée par le passage éclair de Célestin V à la Papauté. Pour Louis Charpentier, l’arrivée de l’Arche en France date de 1128 et coïncide avec le retour d’Hugues de Payns.), dans le Razès sous la protection de familles influentes. Il y rejoint la table des pains d’oblation ainsi que le chandelier à sept branches provenant du sac de Rome en 410.
Une longue période de troubles commence : la croisade albigeoise, l'éradication du temple, la peste noire, la guerre de cent ans, la chute de Constantinople, les guerres d'Italie puis les guerres de religion. La Renaissance esquisse une sortie de crise timide sous la férule de l'inquisition.
En 1645, un simple berger, Ignace Paris, récupère une brebis tombée dans une faille aux alentours de Rennes le Château et découvre un trésor. Il s'en confie au curé puis à l'évêque d'Alet, Mgr Nicolas Pavillon, trop heureux de cette manne fabuleuse qui lui tombe du ciel. Le seigneur des lieux, Blaise d'Hautpoul, l'apprend et intente un procès à l'évêque pour récupérer la jouissance du bien. S'ensuit un imbroglio juridique qui finit par tomber dans des oreilles indélicates ! Celles de Louis XIV et de son surintendant des finances, Nicolas Fouquet.
A la même époque, Nicolas Poussin travaille à Rome à la réalisation d'une commande du Cardinal Rospigliosi sur le thème de la mort. Pour cela, les portes des archives secrètes du Vatican lui sont ouvertes. Il rencontre en 1633, Charles II Créqui de Blanchefort, duc de Lesdiguières, pair et maréchal de France, conseiller du Roi Louis XIII et du Cardinal Richelieu* (Ollivier Ruca), et plus tard, Louis Fouquet en mission de collecte d'œuvres d'art pour son frère Nicolas.
Le chef d'œuvre est achevé en 1638, d’après les experts du Louvre, et s'intitule "les bergers d'Arcadie" seconde version.
Poussin a-t-il été en contact avec Nicolas Pavillon comme le prétendent certains chercheurs ? Les dates ne coïncident pas. Par contre les sources peuvent concorder et concerner un même sujet. Serait-ce une des manifestations de la causalité formative de Ruppert Sheldrake, qui veut qu’une même découverte puisse être réalisée par des chercheurs indépendants les uns des autres, au même moment ?
Nicolas Fouquet plaça son frère François, en 1659, à l'archevêché de Narbonne dans le but de faire plier Pavillon et de s'approprier au moins le sanctuaire de ND de MARCEILLE près de Limoux* (qui dépendait pour partie des diocèses de Narbonne pour le pouvoir spirituel mais d'Alet pour le temporel (F Daffos)), car à l'abri d'une crypte reposait le trésor du berger Paris soustrait à Blaise d'Hautpoul…
Louis XIV l'apprend par l'instruction du procès qui oppose Blaise d'Hautpoul à Nicolas Pavillon. Il n'a aucune prise sur l'évêque d'Alet, par ailleurs puissant acteur du jansénisme, alors il décide de s'attaquer aux Fouquet. S'en suit l'épisode de Vaux le vicomte et l'arrestation de Nicolas Fouquet qui va permettre à Louis XIV de faire chanter François Fouquet dans le but d'adoucir la détention de son frère. Les subsides lui permettront de construire Versailles !
François Fouquet décède en 1673, mais a laissé des jalons à ND de MARCEILLE (Limoux) dont un tableau représentant une extase de St Antoine* (ou St Augustin ? je préfère ce dernier car c'est le prénom de notre fils et j'aime la légende de l'enfant à la cuillère. Cela peut-être également St Jérôme à l'écoute d'un concert céleste, la musique des sphères chère à Pythagore pour lequel, les nombres sont la musique du ciel).
Dans cette église, une fresque murale raconte, justement, la légende de St Augustin et de l’Ange : « Saint Augustin, Evêque d'Hippone, en Afrique du Nord, se promenait un jour au bord de la mer, absorbé par une profonde réflexion : il cherchait à comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Il aperçoit tout à coup un jeune enfant fort occupé, allant et venant sans cesse du rivage à la mer : cet enfant avait creusé dans le sable un petit bassin et allait chercher de l'eau avec un coquillage pour la verser dans son trou.
Le manège de cet enfant intrigue l'Evêque qui lui demande :
- Que fais-tu là ?
- Je veux mettre toute l'eau de la mer dans mon trou.
- Mais, mon petit, ce n'est pas possible ! reprend Augustin. La mer est si grande, et ton bassin est si petit !
- C'est vrai, dit l'enfant. Mais j'aurai pourtant mis toute l'eau de la mer dans mon trou avant que vous n'ayez compris le mystère de la Sainte Trinité ».

Nicolas Pavillon décède en 1677. Louis XIV va alors poursuivre de ses assiduités le principal conseiller de N Pavillon, Louis du Vaucel, qui s'enfuit avec les archives de l'évêque jusqu'en Flandres où il rencontre le peintre David Teniers le jeune. Du Vaucel va laisser à son tour des traces. Il dépose cinq jalons IHS (Eglise de Quillan) à la manière d'un jeu de piste et commande à D Teniers le jeune un tableau "commémoratif" de l'affaire Pavillon / Fouquet / Louis XIV : les sept péchés capitaux retrouvé à Madrid au musée du Prado où il est répertorié sous le titre : « La tentation de St Antoine », d'abord par le père lazariste Jean Jourde puis par le chercheur Didier Héricart de Thury, ami de Franck Daffos.
Louis XIV est représenté chevauchant un lion. Le lion de Juda, car Louis XIV est fier de sa généalogie secrète qui remonte au roi David*. (Voir les sites consacrés). Le lion de Judas, c’est Jésus. Par ailleurs, le lion évoque les armoiries de la capitale des Gaules qui s’appelait autrefois Lugdunum, dont la racine « Lug » vient du latin « Lux », la lumière ou du gaulois « lugos » qui désigne le corbeau. Le Christ est bien la lumière de la chrétienté, le Verbe fait chair. Quant au corbeau, il évoque soit le dieu Bran, soit Odin, pour qui, il a une mission de clairvoyance. Ces épithètes conviennent pour décrire le Roi Soleil !
Le dépôt de ND de MARCEILLE est redécouvert par le chapelain Gaudéric Mèche, en 1827. Avec celui-ci, il restaure le sanctuaire à grands frais. Mèche est écarté par sa hiérarchie à ND du Cros près de Caunes-Minervois. Il reste actif dans l’énigme et forme un jeune prêtre particulier : l'abbé Henri Boudet, un érudit féru d'anglicisme et d'archéologie.
Entre temps son successeur à ND de MARCEILLE, Henri Gasc, s'attache à comprendre les dessous de cette nouvelle résurgence du trésor. Gasc rencontre Boudet mais ils ne réussissent pas à percer les arcanes du mystère. En 1879, Gasc est remplacé par Léopold Vannier qui demande à la maison mère de sa Congrégation à Paris les conseils d'un spécialiste qui lui sera envoyé en la personne du père lazariste Jean Jourde.

L'équipe Boudet / Jourde / Vannier reconstitue le puzzle et découvre une ou plusieurs caches. Boudet s'était essayé à l'écriture, il avait édité un ouvrage intitulé "Du Nom de Narbonne" dans lequel apparaissaient certains indices du secret.
On y trouve les liens qui unissent les deux Rennes, le menhir de Peyrolles, le village d'Arques, le mont Cardou et un certain tombeau, placé à un endroit où il n'existe pas encore !!!!

La figure s’accompagne de flèches, qu’il faut régler sur celle du soleil XII. La pyramide centrale marquée d’une croix, représente le Cardou. Son altitude est inscrite en dessous en chiffres romains : 795. Alors qu’il portera 796 sur la carte de la VLC ???
- La flèche à droite de la tour d’Arques, indique La Malboisie. Les flèches à gauche, indiquent dans un premier temps « Les Brugues », au nord-ouest du donjon puis l’aven Paris sur le plateau du Lauzet.
- La flèche sur le menhir de Peyrolles indique l’église de Rennes les bains.
- La flèche sur le « tombeau » indique les ruines du Bézu.
- La flèche de l’araignée gauche indique les ruines de Coustaussa.
- La flèche droite de l’araignée du bas (église de RENNES LES BAINS) indique le menhir. Celle de gauche indique la tour du Moulin qui surplombe les Bals en dessous de RENNES LE CHÂTEAU.
Jourde et Boudet décident de coucher le fruit de leurs recherches sur le papier et cryptent un ouvrage hermétique : La vraie langue celtique et le Cromleck de Rennes les bains, publié en 1886.
La portée sémantique du livre échappe à la critique qui vilipende l'essai.
Ils décident alors de procéder autrement et cette fois de crypter l'énigme comme au moyen âge : dans un livre de pierres. C'est ainsi que voit le jour le projet de restauration de l'église de Rennes le château, choisie pour son importance séculaire. Le prêtre fraichement nommé en 1885, Béranger Saunière (l’abbé BS ou ABS), est informé : la crypte de son église abrite des sépultures anciennes et peut-être des preuves d'éléments occultés de l'Histoire. Charge à lui d'exhumer ces preuves dont nous reparlerons. En échange, il peut prélever les valeurs numéraires qui pourraient se trouver dans ces souterrains.
La suite des évènements va échapper au contrôle des commanditaires.
Béranger Saunière va se révéler sous un jour imprévu : il est ambitieux !
En outre, il découvre, qu’en marge de l’histoire de Rennes les bains, il y a un trésor secret datant de la révolution enfoui dans les environs de Rennes le château.
De plus, il est couvert par sa hiérarchie, en l’occurrence par Mgr ARSENE Billard, qui dort depuis au côté de St LUPIN dans la cathédrale St Michel de Carcassonne. Billard était lui-même sous la protection de l’ancien évêque de Carcassonne, Mgr de Bonnechose. Ce passionné du Pays de Sault dont était originaire la dernière Marquise de Blanchefort, Marie de Négri d’Ables.
Mgr de Bonnechose repose, quant à lui, dans la cathédrale de Rouen en compagnie de Rollon et du cœur du Lion (Richard I er d’Angleterre).
Béranger Saunière connaissait parfaitement la région puisque l’oppidum de Rhedae, le Bals des Couleurs, le plateau du Lauzet constituaient son terrain de jeu dès son plus jeune âge. Il va retrouver la cache du dépôt secret du dernier évêque d’Alet, Mgr De la Cropte de Chantérac.
Mais il s'approche de trop près d'un Secret qui va causer sa perte. Il décède en 1917, deux ans après H Boudet. Reste Jean Jourde.
Jourde décide alors de coucher à nouveau sur le papier, les indices du Secret. Léopold Vannier avait confié son secret à Jules Verne. Jean Jourde choisit un auteur qui vient de se faire connaître avec une nouvelle parue dans la revue "Je sais tout": "l'arrestation d'Arsène Lupin". Il s'agit bien sûr de Maurice Leblanc ! Il va distiller pour Maurice Leblanc, des scénarii très élaborés, inspirés de l’énigme des Rennes.
Jean Jourde décède à Montollieu en 1930. Son évêque, Mgr Boyer, fait mains basses sur une partie de ses archives.
Le secret se perd à nouveau dans les couloirs du temps.
Jusque dans les années 50 où le nouveau propriétaire du domaine Saunière, Noel Corbu, tente de faire revivre l'énigme, à des fins commerciales. Ami de Boyer, il lui emprunte le « dossier Jourde » et le négocie à Pierre Plantard. Ce dernier flaire le bon coup et confie à Gérard de Sède, le sujet aux fins de publication. Peut-être aussi pour faire se délier certaines langues de témoins demeurés muets jusque-là.
L'écrivain en fait un best-seller : l'or de Rennes où Saunière apparaît comme l'inventeur du trésor, ce qui fourvoiera les chercheurs pendant des décennies.
Partie 2/3
La vraie langue celtique et le triangle d’or
Ma première lecture de la VLC fut tantôt amusante, tantôt rébarbative. Certains passages me paraissaient excentriques au vu de mes connaissances historiques ! Mais le monde des chercheurs s’accordait à dire que le livre était codé, alors…
J’ai cherché des explications objectives et irréfutables, mais je suis plus germanophone qu’anglophile ! J’ai toujours reproché aux anglais de semer la zizanie entre la France et l’Allemagne (encore maintenant…) pour empêcher la reconstruction de l’empire de Charlemagne. La seule vraie Europe, à mon sens, est continentale ! Je mets, malgré tout, nos alliés « Pictes » de « l’Auld Alliance » (« Les Stuarts & Dol de Bretagne, Dominique Martel) de côté. Peut-être du fait que l’Ecosse fût longtemps mariée à ma province où évoluèrent des grands noms comme Dagobert II, le bon roi René et Clovis Hesteau de Nuysement.
C’était avant de comprendre que l’anglais n’est qu’un prétexte qui sert uniquement à évoquer une lecture phonétique des mots et surtout de leurs lettres pour découvrir l’explication finale.
Certaines clés m’étaient apparues comme les quatre mots clés de la page 11 : « bren, scura, aune et brugo ».
-
Bren renvoyait au chef de file gaulois « Brennus » mais aussi au Pech de Brens.
-
« Scura », n’apparaissait que trois fois dans le livre, aux pages 11 et 21.
H. Boudet associe ce mot au verbe nettoyer. L’anagramme latine « curas » désigne les soins. Si l’on joint les deux notions, l’idée qui s’impose est celle du rôle curatif des Bains de Montferrand.
-
L’aune, apparaît dans deux autres pages : 18 et 220 où il est question du pays de Sault. L'aune, l'essence d'arbres se dit bergné... mais une anagramme peut être l'AVEN. En effet, dans la VLC, la substitution U en V est possible comme le montre le titre de la carte d’Edmond Boudet : « Rennes celtiqve ». Cette clé introduit une unité de mesure. L’aune était un bâton de mesure des tissus équivalent à quatre pieds environ ou 64 doigts, soit 2/3 de toises, 1 m 22 environ. L’étalon de cette mesure apparaît sur un des piliers de ND de Montferrand en Auvergne.
-
Quant à la bruyère, Dieu sait s’il en pousse partout dans ce Haut Razès ! Mais paradoxalement, le mot n’apparaît que deux autres fois dans le livre, pages 233 et 239 où il est question du Plateau des bruyères et de Goundhill !
A l'été 2018, je suis allé me recueillir sur la tombe de l'abbé à Axat pour le remercier d'avoir pondu une énigme aussi passionnante. Dans le village, sur un panneau indicateur, j'ai lu, comme un clin d’œil, la direction des "Artigues", toponymie chère à l'abbé !
Que de 1 sur sa tombe, "Vanités, tout n'est que vanités ?
Et curiosité, ce n'est pas puni par la Loi que je sache. L'abbé nous incite à tirer le Trait, comme dans cette commune de Haute Normandie où trône un dodécaèdre.
Le 1 mène au 12.
Le Trait, l'index, celui de Dieu au plafond de la chapelle Sixtine, qui anime Adam. En tous les cas, H. Boudet n'aura de cesse de nous montrer la relation de l'Axe avec l'initiale de son prénom !
L'Axe, c'est le H. Et H se transforme en K pour évoquer la « Key ».
A chaque fois que nous quittons RENNES LES BAINS et notre charmante hôtesse Nicole, gérante de l'Hostellerie des Bains de la Reine, je ne manque pas de faire un détour par Débowska Productions, pour acheter des DVD. Ça me fait patienter jusqu'à la prochaine visite.
J'avais été intrigué par un chercheur, Daniel Dugès* qui signalait un axe majeur de la cartographie de RENNES LES BAINS : Fortin du Bézu / Tombeau du Pas de la Roque (?)/ Maison gauloise / Fontaine des hounds / fortin de Blanchefort (qu'il assimile au Golgotha, nous y reviendrons). (In : Le cromleck de l’abbé Boudet)
Voici l’Axe.
Et Boudet s'emploie à l'incurver cet axe. D'abord en arc pour épouser le fer de la hache celtique, puis en cercle...
En to pan.
Force est de constater que le nom de Blanchefort est intimement lié à l'énigme. Certains descendants de la famille Hautpoul se sont même acharnés à récupérer le Marquisat, preuve s'il en est de l'extrême importance du site. Sur la carte IGN au 1/25 000 ème, la zone de confluence de la Sals et du Rialsesse s’appelle toujours : « Domaine de Blanchefort ».
Nous tenons là une piste.
Qui plus est, la distance qui sépare les ruines de Blanchefort de celles du Bézu est de 636 décamètres.
Et il est possible de tracer un cercle qui inclue ces deux destinations. Il passe en plus par Rennes le Château. Alors…
L'arc passant par ce segment englobe le petit monde de Rennes les bains.
Braves Atacini, forgerons de l'Eternel et braves curés foreurs de trous comme celui du défilé de l'Aude au sud d'Axat. Bizarrement, la digression sur ce valeureux peuple précède celle sur le Cromleck de Rennes les bains...
La lettre H comporte deux perches à réunir.
L’arbitre, au rugby, annonce « Poteaux » comme choix à la pénalité.
Deux traits parallèles comme ceux de la voie ferrée qui nous invite à ne pas dévier (Dé vie est) surtout lorsque l'on fait des jeux de mots (to pun), ou ces deux méridiens issus de Paris.
Mais qu'est-ce qui a bien pu inciter les Sulpiciens à doubler le Méridien 0, d’une ligne rose ?
Rappeler au Roi qu'il n'est qu'un objet pour la religion, ou qu'il puise son pouvoir à la même source ? Ou que la Torah appelle deux Messies ?
Si l'on abaisse à gauche la traverse horizontale des buts rugbystiques, on obtient un N inversé.
Que d'inversions dans cette histoire.
Il s'agit même d'une clé du trousseau.
Inversion de lettres, de tours, de villages. La Rennes d'en haut et celle d'en bas sans que cela soit péjoratif car comme l'enseigne la table d'émeraude : "il est vrai, sans mensonge, certains et très véritable que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose".
Pour les tours, il faut suivre Alain Feral. Des tours qui montent et des tours qui descendent... et des plans décalés !
Une explication possible est livrée par la petite église templière de St Pierre aux liens sur la commune de Serres.
En 2000, la restauration de l’église mis à jour des fresques du XIII ème siècle dont celle de l’arc en plein cintre qui délimite le chœur. Cette fresque représente deux croix jointes par le même patibulum dont seule celle de gauche porte une inscription (« INRI ») sur son titulus.

Deux montants unis par le même lien, comme la lettre H ou comme deux méridiens unis par le palindrome « Serres ».
A l’horizon du 21 ème siècle et de l’entrée de l’humanité dans le troisième millénaire, Paul Chemetov proposa de matérialiser l’emplacement de l’ancien méridien de Paris, commandé par Louis XIV aux Cassini.
Mais bizarrement la borne devant matérialiser cette méridienne verte fut placée à proximité du pont « romain » de Serres, à 1 Km à l’ouest du méridien 0 (qui passe au col dal Pastre), sur le méridien qui passe sur l’église !
Indice déterminant.
Au XIII ème siècle, la seigneurie de Serres est une possession de l’évêque d’Alet (« praepositus de Serris », 1283). Plus tard, elle est cédée à des « particuliers » (site « monumentum »). Le château date du XV ème siècle. Il a été construit « sur les ruines d’une construction médiévale ».
A quel endroit ? : À 117 m à l’ouest de l’église, soit 4,7 mm sur une carte IGN au 1/25 000 ème. Exactement le dixième de l'espacement entre le méridien 0 et la « rose ligne » saint-sulpicienne !
Cet indice est primordial. Il date de l’époque cathare et a été relayé en l’an 2000. Il s’agit d’un secret d’état.
Le méridien « Serres », coiffé du titulus INRI, aligne les créations boudétiennes : le Roko fourkado qui ouvre le cromleck sur la rive droite de la Sals (p 228), les Lampos (p231), le menhir couché du Bazel (p230), Foucilhe (p292). La ligne se poursuit près de la roche du Dé sur le Serbaïrou et finit au hameau du Mas près de la Vialasse sur la route de Rennes les bains à Bugarach… La fin du trajet longe le bord d’un plateau, qui surplombe un ruisseau asséché, qui se jetait dans la Blanque. Nous verrons plus tard que le hameau de la Vialasse a une importance toute particulière.
Il faut se rappeler pour la suite de cette enquête, que le méridien vert « occulte » se déduit du précèdent.
Le Trait attend désormais le nombre Trois et la première figure géométrique, le triangle.
« Toute forme, quelle qu’elle soit, génère une énergie, des vibrations, tout comme une onde, d’où le nom d’ondes de formes. Les travaux de chercheurs, comme Bovis, de Bélizal, Morel et Chaumery, ont mis en évidence l’existence et les impacts de ces types d’énergie ».
L’auteur qui me révéla le fonctionnement de la VLC, je le nommerai Sganarelle, du verbe italien sgannare, qui signifie « dessiller » (ou, pour mieux définir, « amener à voir ce qu'on ignore ou ce qu'on veut ignorer »). Cet auteur excella dans ce rôle sur une scène où l’amour courtois fût Roy !
Sganarelle est passionné de mathématique et de géométrie.
Il jongle avec les chiffres et les angles. Je lui trouve le mérite d’avoir su isoler un montage du texte de la VLC, basé sur la géométrie d’Euclide et de Pythagore où le Nombre d’Or est roi.
Par exemple, du milieu du livre (p154-155), il extrait le jeu des petits chevaux. Son explication de l’expression « Cheval de Dieu » est savoureuse et très seyante !
De plus, aspect que je n’avais pas envisagé, il faut une version originale de l’œuvre et non pas une version « moderne », à la pagination et aux césures du texte non respectées, pour travailler.
Boudet construit son livre comme un monument, en maçon.
Aucun détail n’est à négliger.

Bien, donc Sganarelle extrait le passe-partout (un rossignol du nom du cryptographe de Louis XIV) qu’est le triangle géométrique d’or ou TGO définit par des nombres entiers, unis entre eux par Phi et ses déclinaisons, en particulier sa racine carrée. Ses dimensions : base x (1 + √(φ) + φ). 1 + 1,272 + 1,618 = 3,89 = une clé.
Le tiercé gagnant est 500 / 636 / 809. Ces dimensions confèrent au triangle un périmètre de 1945 unités.
D’autres triangles, pages 114 et 115. Page 116 (signature pythagoricienne de Boudet), il isole les lettres du nom de l’abbé, dont le total renvoie à la page 112, qui elle-même renvoie à la première page du Cromleck (p224), puis à l'ouverture de celui-ci page 228 (112+116). Page 225, apparaît le nombre d'Or (Philistins) ainsi que le périmètre du cercle en kilomètres (16 à 18. Sganarelle calcule 18,46 à partir des Bergers de Poussin).
Page 292, le centre est livré.
Page 138, le triangle de Pythagore 6 8 10 abrite un G qui évoque la "méridienne 618"* (23 ème ligne de la page 138 à soustraire de la 15 ème ligne marquée par un S qui marque la 49 ème première lettre de ligne d'une série courant sur 138 pages..., triangle qui enferme la date de 626 après JC. 626 - 8 = 618).
Ce sacré 618, une autre clé, anagramme numérique des trois nombres 6, 1, 8 révélée par une sentence sur laquelle nous reviendrons.
Sganarelle extrait du tableau de St Antoine à ND DE MARCEILLE, à l’aide de la page 279, le Triangle des Trois Lumières (Père, fils, St Esprit).
Ce TTL est un triangle de Pythagore. La section dorée appliquée au petit côté, indique le point G.
La base de ce triangle, marquée par le chiffre 618 définit une méridienne particulière.
Ce TTL s'insère lui-même dans le TGO définit plus haut par les points suivants :
-
Blanchefort (Bf),
-
Bézu (Bz), hameau,
-
Les Bringots (Bt) au nord-est du village de Bugarach.
Le point G se situe dans le massif Soula de Doumeng / La Garosse, limite sud de la carte Boudet, exactement à l'emplacement du seul dolmen présent sur cette carte, celui de la légende !
Cerise sur le gâteau, les excellents outils géoportail permettent d'établir l'altitude du point : 618 ! Point sur lequel, passe le méridien 0.
Voilà enfin expliquée l'expression "méridienne 618".
Thierry Garnier dans le Mercure de Gaillon, à la page VLC circuit, étudie l'importance de ce site coincé entre la Soula de Doumeng, la Garosse et la Calvière avec toutes les références boudétiennes.
Avec mon épouse, nous nous sommes rendus sur les lieux. Dans une forêt de châtaigniers, nous découvrons une mare tourbeuse gardée par une cabane de branchage. L’endroit est glaçant ! La cabane semble habitée par une entité antipathique et nous comprenons qu’il faut vider les lieux, bien vite !
A la réflexion, cette mare me fit penser au bénitier de l’église de Rennes le château gardé par Asmodée (ou Abibala, l’assassin de maître Hiram d’après Daniel Dugès).
L’idée me vint alors de projeter le plan de cette l’église sur la carte IGN en faisant correspondre le point 618 avec le bénitier et les fonds baptismaux avec la pique de Lavaldieu (lava le Dieu).
Henri Buthion affirmait que l’ABS avait découvert des indices en plaçant le schéma de la dalle mortuaire de la Marquise de Blanchefort sur le plan de l’église, le poulpe calé sur le cœur. La + de A D+I avait révélé l’importance du clocher issu d’une ancienne tour du château ancestral. L’oméga révéla l’emplacement de la dalle des chevaliers permattant d’arriver à la crypte. La + de A + PX mena à la cache dans le mur sud. C’est ce qui incita l’ABS à réserver cette place à la riche statue de St Antoine de Padoue, (« vieux grigou vieux filou, rendions-nous ce qui n’est point à vous » !), porté en triomphe par quatre anges, tel un roi antique.
Alors j’ai pratiqué de même. La double projection place la + de D + I sur la cache de Blanchefort tandis que la + de A + PX pointe le bois au sud du lac d’Arques. Le poulpe cible la Sarrat de la Frau tandis que la double flèche PS / Prae-cum se place sur la ligne menhir de Peyroles / fontaine Marie-Madeleine à Rennes les bains. A suivre.

Il est possible de projeter le TGO dans trois autres directions différentes, toutes aussi intéressantes.
Petit côté en haut à droite, G pointe la région de Montferrand.
Petit côté en bas à gauche, G pointe le Col Das Bordos près de Las Bordos del Soula sous Le Bézu.
Petit côté en haut à gauche, G pointe le lieu-dit « Mouscaïrol » au NE de Rennes le château.
Voilà introduit le tableau de Nicolas Poussin.
De la pierre brute à la pierre taillée.
Partie 3/3
Les bergers d'Arcadie
Si l'on admet que la deuxième version des bergers d'Arcadie de Poussin renferme un secret alors il doit être possible d'en tirer un schéma directeur, transposable sur différents supports.
Le but n'est pas de faire une énième étude des Bergers. Des chercheurs bien plus talentueux que moi ont produit des études passionnantes. Je ne retiendrai que quelques pistes opératives.
Le tableau fût inspiré, selon Bellori, par le cardinal Rospigliosi, futur Clément IX. Il aurait suggéré à Poussin,
« L’idée d’une réflexion sur la mort, sur le tombeau et sur le temps ». Le tableau mesure, encadré, 121 cm sur 85.
Poussin, dans une lettre, a déclaré qu'il était " un disciple de la maison et du Musée du cavaliere dal Pozzo." Secrétaire du cardinal Francesco Barberini, neveu du pape Urbain VIII, ce collectionneur était passionné d'alchimie. Il correspondait avec des personnes connues comme Galilée. Dal Pozzo était un lien majeur dans le réseau de scientifiques européens et la Société « Angélique » à laquelle adhérait également Créqui de Blanchefort, un diplomate français proche de Richelieu, qui entra en contact avec Poussin au moment où celui-ci était immergé dans les archives vaticanes pour réaliser la commande (Ollivier Ruca).
Que voyons-nous dans ce tableau :
-
Quatre personnages (trois hommes et une femme),
-
Trois bâtons,
-
Deux pierres parallélépipédiques (une brute sur laquelle s'appuie le berger "rouge", une taillée, le tombeau). Un élément de réflexion que je n’ai jamais vu mentionné : l’angle que fait le biseau derrière la Dame et le plateau supérieur du tombeau est de 154°.
-
Un paysage arboré d'arrière-plan, lui-même subdivisé en trois secteurs.
Les arbres sont groupés par deux : de gauche à droite,
-
Deux couples de Hêtres (fagus sylvatica, très fréquent sur la Serre de Bec et le crêt d’Al Pouil),
-
Deux chênes verts (Quercus Ilex),
In robore fortuna, la fortune est dans le chêne ou au pays des chênes, « oak » en anglais, le « land d’oak »,
-
Deux troncs de Pins dont les frondaisons sont hors cadre, celui de gauche indique l’Axe,
-
Et deux charmes. Il est possible également que les hêtres, soit en fait, des ormes, qui pourraient évoquer la Rome antique, par anagramme, mais aussi la mort ?
Pour moi, le rocher central représente la pique de Lavaldieu ; à droite, une vue du château du Bézu ; à gauche, une vue du Cardou et de Blanchefort, à partir de la route de Couiza.






Les éléments qui accrochent mon attention : l'attitude des personnages plus que leur identité, les bâtons, les trompes l'œil, les fentes (failles ou catins) dans ce tombeau si bien taillé, les ombres sur les lettres de l'inscription.
Pour les personnages, honneur aux dames, le personnage féminin est particulièrement étrange. Elle me paraît habillée à la mode romaine. Elle semble aveugle ou absente, c'est l'inconnue invariable. Sa main droite posée sur l'épaule droite du berger rouge, dessine une équerre.
Cette attitude est démonstrative.
En effet, le pouce placé, perpendiculairement aux autres doigts, dessine un triangle rectangle de dimension 1 / 2 / √5 permettant ainsi de calculer le nombre d'Or, Φ, égal à peu près à 1,618* ((√5+1)/2).

Nombre aux propriétés peu communes :
φ/ (φ-1)= 1+ φ = φ² = 2,618.
D’après la légende, trois tables ont porté le Graal. Une table ronde, une table carrée, une table rectangulaire. Toutes trois ont la même surface et leur nombre est 21 ou 2/1. La table rectangulaire de dimension 2/1, le carré long des moines bâtisseurs, contient la racine de la transformation d’une surface angulaire en surface circulaire. En effet, φ² X 12/10 = π. π symbolise Dieu, φ son harmonie. π - φ² = 0,5236 = π /6, la coudée royale, mesure de Dieu.
Par ailleurs, la Dame est la seule personne à se tenir droite. Or, si on estime sa taille avec un instrument de mesure, le bâton du berger bleu par exemple, on se rend compte que la longueur de cette pige (qui ressemble d'ailleurs à un pied de biche…,
permettant de lever un lourd secret …) multipliée par φ donne la hauteur de la Dame. Ce qui est un des canons artistiques du corps humain* (la distance du nombril au sol X φ = taille de la personne). Ce bâton de mesure ne peut être que l’aune, car en effet, seuls 4 pieds sanglés sont nettement visibles sur le tableau. Il ne s’agit donc pas de l’aune de Paris qui vaut trois pieds 7 pouces 10 lignes 5/6, soit 1,182 m. N’oublions pas que nous sommes dans la région du schisme cathare, en révolte contre la règle officielle défendue par le Pape assisté du Roi de France. Lorsque l’aune de Paris sera évoquée, le U sera remplacé par le V. Il s’agira donc de l’aven Paris, le seul aven mentionné sur la carte IGN de la région, sur le plateau du Lauzet.

Donc pour moi, la Dame incarne la lettre Phi et sa valeur numérique. D'où son caractère imperturbable, car même si le berger rouge semble lui demander confirmation, rien ne transparaît dans les traits de son visage.
Pour le berger bleu, c'est plus facile, il transpire les traits d'Hercule, Héraclès en grec, R à clés. Ses travaux sont légendaires. Les poètes grecs le nomment Alkidas d’après Bernard Roger, « d’alké » qui désigne la force agissante, la puissance. La lettre Rech en hébreux, symbolise la tête et le commencement, le cap de l’homme. R comme roi …
Sa jambe droite adopte le profil du cours de la Sals à RENNES LES BAINS. Son pied droit repose à l’emplacement du « bénitier », à la confluence de la Sals et la Blanque, précision supplémentaire pour situer la place du tombeau dans ce diocèse.
C’est le seul personnage dont on voit les deux pieds et il montre la lettre R. Il nous indique la formule : 2 𝛑 R qui est le périmètre du cercle. Son avant-bras droit indique la diagonale de la scène. Il faut alors faire coïncider les deux valeurs : périmètre et diagonale du tableau, à savoir √(121² + 85²), c'est-à-dire 147.9 cm, d’où R = 23.53 cm. La mesure du bâton d’Hercule est donc de 47 cm. Ce qui nous donne l’échelle 122 cm (l’aune) représentée sur le tableau par 47 cm.
La Dame est une géante de 1 m 97 ! Presque la taille du menhir de Peyrolles (2,20 m de haut). Car une autre identification possible pour la Dame est de la comparer à cette pierre dressée, « Peyro dreyto ». En effet notre Dame est la seule personne droite de cette scène des bergers d’Arcadie et elle paraît pétrifiée. Le fait qu’elle ait la tête penchée la rapproche un peu plus du menhir (qui est penché) sans diminuer sa taille car en anatomie, le sommet du crâne est le vertex.

Au berger rouge maintenant.
Le pied posé sur une pierre grossière, il indique un joint du tombeau, faisant ainsi le lien entre le grossier et le presque parfait.
Sa tête représentée de face fait un angle impossible avec le reste de son corps. Elle est trop petite. Avec ses cheveux hirsutes et sa couronne, ce personnage m'a toujours fait penser à Méduse (M) plutôt qu'à Mercure. C’est peut-être la raison pour laquelle, la « bergère » ne le regarde pas !
Dans la mythologie, Persée tranche le cou de Méduse. Il s’en échappe Pégase, la monture des héros. Dans le ciel nocturne, cette constellation fait face à Orion, Hercule et la grande Ourse. Grande ourse que l’on retrouve sur la tentation de St Antoine de Teniers le jeune, au-dessus de la « poule » qui porte le chiffre 4, et guerroie en l’air sur un poisson.
Ce personnage pointe un trait vertical situé plus à gauche du Méridien de Paris, incarné par la Dame. Il reçoit l’assentiment de celle-ci, preuve qu’il a raison de ne pas choisir la voie officielle. Cette ligne est brisée par deux éclats, des failles ou des « catins » ?
Son pied gauche est vraiment mis en évidence. C’est le Pi (ed) à Gor(gone). Le rocher sur lequel repose son pied a été comparé à la proue d’un navire par le chercheur Ollivier Ruca. La poupe est dessinée par l’ombre d’Hercule et le mat est le bâton du berger rouge. Il a associé à cette figure, le château de Puivert. Cette théorie excentre beaucoup trop le débat. En fait un autre château, peu connu, en forme de bateau, existe dans la région de Rennes les bains, à l’emplacement de la signature d’Edmond sur la carte. Il s’agit du château de « la Vialasse », voir cette photo prise des ruines du Bézu, d’où l’on a une vue magnifique sur le territoire de chasse de nos curés.

Le berger blanc est vêtu d'un linceul.
Il a les pieds nus. Les autres ne semblent pas le voir. Ils l’imaginent à l'intérieur du tombeau car il est considéré comme mort. C’est une scène de recueillement et d'interrogations : le corps est-il toujours dans le tombeau car sinon la mort n'existe pas, même en Arcadie ; ou ce tombeau est un fac-similé qui porte un plan pour trouver la vraie tombe, auquel cas la mort est tristement présente, même au royaume des Dieux !
Il a le mérite d'apporter trois repères importants :
-
La place de son bâton,
-
La direction qu'indique son index gauche,
-
Son statut de ressuscité célèbre. « Je suis l’alpha et l’oméga », le début et la fin, donc l’aleph et le Tav dans l’alphabet hébraïque (Ulpian), deux lettres qui situent le lieu de la résurrection : le diocèse d’Aleth.
Les trois couleurs arborées par les bergers sont celles du troisième œuvre alchimique. Ce travail
titanesque démarre justement par des préparatifs fastidieux comparés aux travaux d'Hercule. Leur sort est lié comme le sont leurs index qui sont alignés. C’est une ligne majeure. Malheureusement, cette indication manque de précision, compte tenu des références cartographiques de l’époque.
Jean Pelet, l’un des tous premiers chercheurs, affirme que les trois bergers veillaient, chacun, sur un secret particulier. Le berger rouge, sur la lignée royale de Dagobert II par son fils Sigebert IV. Le blanc, sur la lignée du Christ protégée par les chevaliers du temple. Et le berger bleu, sur un secret détenu par la famille de Blanchefort.
Concernant les bâtons, nombreux sont les chercheurs qui ont décrits les lettres qu'il est possible d'extraire de leur position, je n'y reviens pas. On peut relever, également, les angles fait avec le méridien 0 : 185 ° pour le bâton rouge, 340° pour le bleu et 345° pour le blanc. Nous verrons par la suite si nous pouvons exploiter cette information. Ci-contre, 185° depuis le menhir de Peyrolles, nous mène sur les rives de la Blanque, entre le pont romain et Bugarach.
Sachant que le nombre d'or régit la scène, est-il possible d’en déduire un plan permettant la recherche du tombeau dans le monde réel ?
Bon je ne vais pas vous mentir, j'ai autant de patience qu'un chat qui a la queue prise.
Si on part du principe que la VLC avait pour but de préciser un secret trop profondément enfouit dans les bergers d'Arcadie, seconde version, c'est qu'il indiquait déjà le même chemin.
Appliquons donc le TTL sur le tableau, en prenant comme attache l'extrémité haute du bâton du berger blanc. Et là, miracle, l'angle droit du TTL épouse l'angle externe de l'œil gauche de la Dame Phi et tombe au sol comme dans l'expérience du scarabée d'or (The golden Bug) d'E. Poe ! Mais là où tombe le scarabée, ce n’est pas encore la cache ! Il faut compter cinquante pieds : « Jupiter nettoyait les ronces avec la faux. Au point trouvé, il enfonça une seconde cheville qu’il prit comme centre, et autour duquel il décrivit grossièrement un cercle de quatre pieds (l’aune) de diamètre environ. »
Les dimensions du triangle : la base mesure la longueur du bâton d’Hercule (R à clés) multipliée par √ φ : 1,272 b. La hauteur mesure b x (√ φ x √ φ), c à d b φ, 1,618 b. L’hypoténuse : b x √(φ + φ²), comme φ²= φ + 1 , donc b √(2φ + 1) soit 2,058 b.
Où tombe le point G ? En bout de l'index gauche du berger blanc ! Il y a peut-être du vrai dans tout ça !


Voilà pour le tableau. Qu’en est-il sur site ?
Les inscriptions du tombeau et les analyses de Sganarelle, vont nous aider. Sganarelle compose à partir des deux locutions "Et in Arcadia ego" / "Rennes celtique", deux anagrammes :
-
"Tire en arc ce qui est en diagonale",
-
"Et diagonale ici en centre Arques".
Concernant l'inscription et les ombres projetées, bien des choses très intéressantes ont été écrites, je n'y reviens pas.
Pour moi les lettres vraiment apparentes : E RCADO (ou U, à droite du bâton du berger rouge) EG en dessous : En CARDO Est G ?
Enfin un détail jamais mentionné, à droite de la bergère et du tombeau est représentée une petite habitation. La demeure des bergers ? Qui deviendra la villa Béthanie ?
Concernant les failles, j'adhère à la démonstration de Vincent Moreau, l'administrateur du site Arcadya681.
Un si beau tombeau et déjà des fissures, ça dégoutte !
D'accord avec le principe des confluences. Du reste, au vu des déformations de la carte de la VLC, seules les confluences des rivières peuvent permettre des repères immuables.

Un autre indice nous est fourni par le crapaud à la pipe qui tire sur la cape de St Antoine dans le tableau de la Tentation de St Antoine. Ce faisant, il découvre la robe du saint homme dont les reflets dessinent une forme qui

rappelle le socle de la croix sur l’autel devant la grotte.
Jean Pierre Garcia fait judicieusement remarquer que les personnages qui représentent « les péchés », sont affublés, soit de pieds griffus, soit d'oreilles pointues, pour dire qu'ils sont possédés par un Démon.
C’est le cas de la « courtisane », la luxure, du « bon vivant » vêtu d’écarlate (la gourmandise), bardé de saucisses, un verre d’eau dans une main, une cruche dans l’autre (contenant de l’eau salée ? La Sals…) et de la peseuse triste, soi-disant avare...
Le prélat, car c’est Nicolas Pavillon qui est évoqué ici, chevauche une monture aux

pieds de cochons. La tête du destrier a été remplacée par un crâne de sanglier d’après les exégètes.
La courtisane est en fait Marie-Madeleine de Castille seconde femme du paon, Nicolas Fouquet. Est-ce qu'il lui est reproché de se remarier, auquel cas la scène représentée ici est un "charivari" dont le branle est mené par David Teniers le jeune lui-même (dixit Sganarelle) représenté sous les traits du joueur de luth à droite de l'autel. Elle endosse ainsi le rôle d'une autre « pécheresse » sortie tout droit des saintes écritures et qui porte le même prénom.
St Antoine serait-il tenté d'"officialiser" un mariage réprouvé ?
Le prélat et elle sont armés de serres de rapaces, des serres d’aigles ? Peut-être parce qu’ils se sont battus « bec et ongles » contre Louis XIV pour préserver leurs intérêts. Le prélat se gausse de la « colère », car il se sait inattaquable ! Quant à la courtisane, son regard marque l’inquiétude. Son sort et celui de ses enfants a été beaucoup moins simple à gérer.
La peseuse, n’est pas plus gaie. Elle est consignée à cette tâche. Au vu de ses modestes atours, elle n’est ni banquière, ni préteuse sur gages. Sa condition la rapproche de deux autres femmes du tableau. Celle qui se lamente sur son âne, la paresse ? mais qui semble surtout préoccupée du sort qui l'attend : celui de la pauvre créature victime des foudres de la colère alors qu'elle essaye juste de survivre des bienfaits d'une simple pomme.
Cette femme symbolise bien la précarité de la classe paysanne sous Louis XIV. Pourtant la balance que manipule la peseuse, évoque celle d’un changeur mais avec une particularité : l’un des plateaux est rond et l’autre, carré ou triangulaire, comme si nous étions invités à changer les surfaces angulaires en surfaces circulaires, c’est à dire à réaliser la quadrature du cercle, à réaliser l'impossible. Et c'est bien ce qu'elle opère. Elle transforme les rondelles grises des sacs posés derrière, en bon or sonnant et trébuchant estampillé des initiales P et F pour Pavillon et Fouquet. Son démon est « Mammon », pour désigner le précieux sel d'Ammon que les alchimistes du XV ème siècle utilisaient pour faire régner l'harmonie dans la matière.
Le seul vice que l'on peut alors lui reprocher est peut-être la tromperie ?
Le tableau de Teniers le jeune donne une autre précision, le plan des salles souterraines à découvrir (à plusieurs niveaux…).
Ce plan sera repris par Jules Verne dans « deux ans de vacances » et par Maurice Leblanc pour servir de décor à l’île aux trente cercueils du nom de Sarek.
Rappelons que la poule, haut perchée, défend l’entrée du haut, la plus étroite… Dans « Au pays de la Reine blanche », Pierre Plantard affirme en effet que la pensée médiévale associait les trois rochers gardant l’entrée nord de Rennes-les-Bains (Rocko-Negro, Roc Pointu, et Blanchefort) aux trois rois Mages ».
Face à eux, les rochers de « Lampos ». Sganarelle nous signale, fort justement, que ce terme désigne l’un des chevaux qui tirent le char d’Apollon et Aurore …, un cheval de Dieu !
Enfin, une constante de l’énigme consiste à placer un rocher parallélépipédique (pierre du Dé) en repère, sur place, de l’entrée de l’aven. Ce rocher est représenté sous la forme de l’autel de St Antoine.
« Ad Génésareth », les lettres décalées vers le haut dans le grand manuscrit (au milieu, JP Garcia). A Dé genèse arête (Ulpian).
Quoi qu'il en soit, ces tableaux ne laissent pas indifférent car ils sont constitués sur les bases de la théorie des champs morphiques.
"Les champs morphiques sont des schèmes (des logiciels sans supports) d'influence organisateurs potentiels, susceptibles de se manifester à nouveau, en d'autres temps, en d'autres lieux, partout où et à chaque fois que, les conditions physiques seront appropriées. Le processus par lequel le passé devient présent au sein de champs morphiques est nommé résonance morphique. La résonance morphique implique la transmission d'influences causales formatives à travers l'espace et le temps".
In:http://www.unisson06.org/dossiers/science/sheldrake_champs-morphiques.htm.
Reste le problème des trompes l'œil dissimulés dans le tableau de Nicolas Poussin. Ils sont légions, du chien au navire, de l'œil à la coupe sans oublier les visages dissimulés, dans les bandelettes des caligae, le turban de la bergère lui donnant un air de Janus (le maître des portes). D'autres chercheurs ont approfondi ces aspects. Diverses figures peuvent également être isolées, des cercles, des pentagrammes, des sceaux de Salomon. Mais aussi des lettres, N à l'endroit ou inversé, des A. Ceux de la société Angéliques ("brouillard"), ou de l'Académie d'Arcadie, chère à la reine Christine de Suède. Les A de la société jésuite de Mazarin. Le sujet est inépuisable.
Pour les cercles, je retiens naturellement, ceux isolés par Sganarelle. Le diamètre est matérialisé par le bâton du berger rouge. Le centre est sous son avant-bras gauche.
Il est temps de passer aux autres indices couchés sur des supports plans quadrangulaires ou presque. Il s'agit des pierres gravées* et des manuscrits.
* Les pierres gravées « du Languedoc » (http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/elements_insolites/images/Pierre_gravees.pdf ).